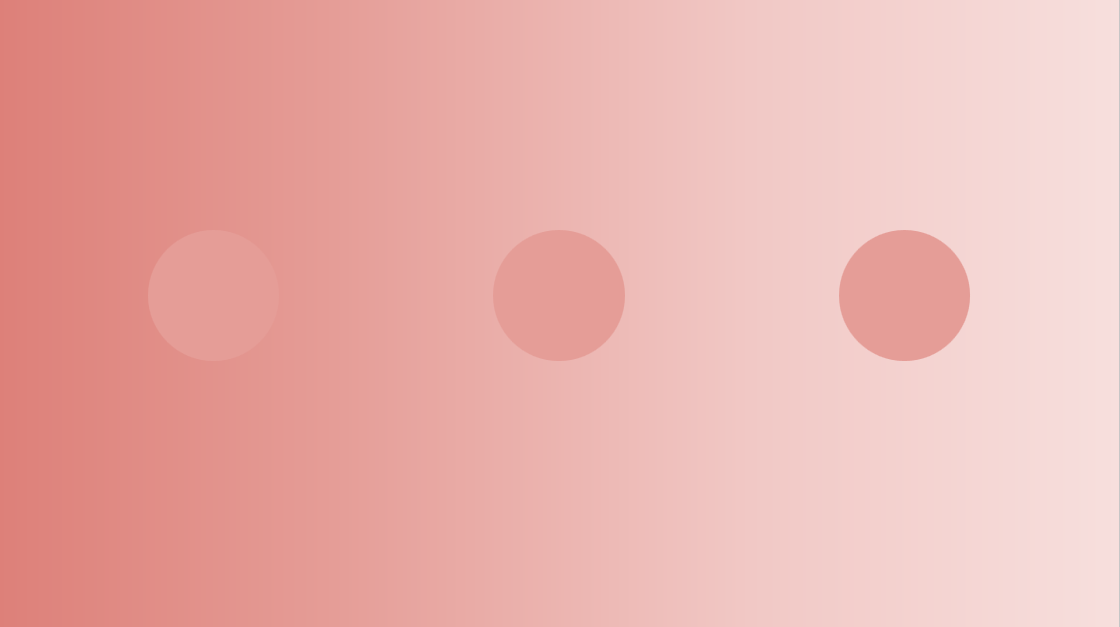Les illusions du Change Management (2/3) – la compréhension

L’illusion de la clarté : croire qu’on comprend un changement avant de l’avoir vraiment analysé
Les illusions du Change Management (2/3)
Les illusions du Change Management (2/3) – la compréhension
Chaque transformation commence avec une promesse claire : améliorer la performance, simplifier les processus, renforcer la collaboration ou encore enrichir l’expérience client. Des plus simples aux plus complexes, toutes partagent pourtant le même défi : l’adoption.
On le sait aujourd’hui, le changement ne s’ancre pas naturellement — ni durablement — simplement parce qu’il a été annoncé. C’est pourquoi les organisations font appel à un Change Manager, dont le rôle est de rendre le changement vivable, compréhensible et actionnable pour ceux qui le vivent.
Le travail d’un Change Manager s’articule généralement autour de trois grandes phases :
- Analyser et comprendre ce qui change — c’est la première étape, la pierre angulaire de toute démarche : l’analyse d’impact.
- Mettre en œuvre, accompagner et suivre, à travers des plans d’action adaptés à chaque population concernée.
- Ajuster, renforcer et ancrer, pour transformer l’adoption initiale en changement durable.

C’est dans cette première phase — l’analyse d’impact — que se joue une grande partie du succès d’une transformation. L’analyse d’impact à pour objectif de comprendre, de manière à la fois qualitative et quantitative, ce qui va changer :
- Qualitativement : qu’est-ce qui change ? pour qui ?
- Quantitativement : quand, où, dans quelle mesure, et pour combien de personnes ?
Elle permet d’identifier les groupes impactés — équipes, départements, business units, sites — et de comprendre comment chacun vivra différemment le changement.
D’une certaine manière, l’analyse d’impact en Change Management, c’est ce que l’analyse fonctionnelle est à l’informatique : un travail de conception structuré, sur lequel se construisent toutes les actions suivantes. De la même façon qu’on ne peut pas développer un système sans exigences claires, on ne peut pas réussir une transition humaine sans comprendre profondément ses impacts réels.
Un Change Manager n’applique pas de recettes toutes faites. Il observe, questionne, synthétise, et conçoit des plans d’action sur mesure, adaptés à chaque groupe concerné par le changement. Et c’est précisément à ce moment que se révèlent à la fois la valeur et les illusions de cette étape.
Les 5 illusions
L’analyse d’impact est l’une des étapes les plus essentielles, mais aussi les plus souvent mal comprises du changement. Elle demande du temps, de la clarté et de la collaboration — trois ressources souvent limitées dans les organisations modernes.
Au fil de près de vingt ans de pratique, j’ai identifié plusieurs illusions récurrentes qui en fragilisent souvent la portée.
- L’illusion du temps disponible
On part souvent du principe que les managers « trouveront un peu de temps » pour contribuer à l’analyse d’impact. En réalité, dans les transformations les plus complexes, ils sont déjà fortement mobilisés par leurs responsabilités opérationnelles quotidiennes, par les analyses fonctionnelles liées à la transformation des processus ou des systèmes, et par les échanges autour des aspects humains du changement.
Pourquoi parler autant des managers ?
Parce qu’ils jouent un rôle central dans la réussite de toute transformation.
Quand je parle de manager, je l’entends au sens large — toute personne responsable d’une équipe, du CEO au team leader de terrain. Ce sont eux les partenaires clés du Change Manager : ils connaissent la réalité du terrain, ils ont la légitimité pour agir et pour s’exprimer, et ils bénéficient de la confiance de leurs équipes.
C’est précisément pour cela qu’ils sont des contributeurs essentiels à l’analyse d’impact — et que leur disponibilité (ou leur manque de disponibilité) en influence directement la qualité.
Mais cette disponibilité est souvent plus théorique que réelle. L’accumulation des sollicitations rend difficile la prise de recul nécessaire pour réfléchir en profondeur à la manière dont le changement affectera leurs équipes et leurs activités. Et pourtant, c’est un moment crucial — qui demande à la fois du recul et de la disponibilité mentale.
Les premières itérations de cette analyse sont donc souvent, assez logiquement, partielles. Il faut généralement plusieurs cycles de questionnement, de recadrage et d’alignement pour parvenir à une compréhension solide et complète des impacts liés à la transformation — de la même manière qu’une analyse fonctionnelle demande du temps pour mûrir.
Et c’est là l’illusion : croire que la compréhension humaine du changement demande moins de temps que la compréhension technique. En réalité, concevoir, comprendre et mettre en œuvre un changement nécessitent souvent autant de temps que développer et déployer une solution technique.
Ce temps d’analyse et de maturation n’est pas du temps perdu —
c’est lui qui sécurise l’adoption.
Et cela nous amène directement à la deuxième illusion : celle qui consiste à penser que parce qu’on l’a déjà fait une fois, c’est suffisant. En réalité, l’analyse d’impact n’est jamais un exercice ponctuel : elle grandit, évolue et se précise au fil du changement lui-même.
- L’illusion de la suffisance
Cette illusion est étroitement liée à la précédente. On pense souvent qu’une ou deux analyses d’impact suffisent à identifier les principaux enjeux et à définir les bonnes actions. En réalité, la compréhension d’un changement évolue au rythme du changement lui-même.
Chaque retour sur l’analyse permet de l’affiner : certains impacts se précisent, d’autres apparaissent, les priorités se déplacent, de nouvelles dépendances se révèlent. C’est un processus vivant, où la clarté grandit à mesure que l’organisation et ses membres s’approprient le projet.
Cette dynamique peut parfois être perçue comme une perte de temps, alors qu’elle en fait partie intégrante. L’analyse d’impact n’est pas un livrable qu’on coche sur une liste : c’est un travail d’exploration progressive, qui accompagne la montée en maturité de l’organisation et de ses acteurs.
Chaque échange, chaque mise à jour, chaque nouvelle discussion contribue à une compréhension plus fine, plus juste et plus partagée de ce qui change. Et plus cette compréhension collective est juste, plus les actions d’accompagnement qui en découlent seront pertinentes, efficaces et durables.
C’est ainsi qu’on passe d’une adoption superficielle à
une transformation profonde et durable.
- L’illusion de l’évidence managériale
Les managers sont les partenaires clés du Change Manager, mais cela ne veut pas dire que conduire le changement est un réflexe naturel, ni qu’ils disposent toujours des outils pour le faire de manière structurée.
Dans ma pratique, j’ai souvent accompagné des managers qui réalisaient une analyse d’impact pour la première fois. C’est toujours un moment d’apprentissage riche : ensemble, on explore les bonnes questions, on identifie les impacts directs et indirects, et on relie le changement à la réalité quotidienne de leurs équipes.
Mais cet exercice demande un état d’esprit particulier : la capacité de regarder non seulement ce qui change, mais aussi ce que ce changement implique pour les personnes, les processus et les interactions. Ce type de réflexion n’est pas inné — il nécessite du temps, du cadre, et souvent un accompagnement.
L’analyse d’impact devient alors un moment d’apprentissage collectif,
autant pour les managers que pour les équipes projet
et le Change Manager lui-même.
C’est là que les perceptions se rencontrent, que les visions globales et locales s’alignent, et que le sens se construit.
L’illusion ici, c’est de croire que cette compétence est innée. En réalité, elle se développe par l’expérience, le dialogue et la confiance — et c’est précisément ce qui rend l’analyse d’impact si précieuse. Au-delà des données et des plans, elle crée une compréhension partagée du changement.
- L’illusion de la vision partagée
Une illusion plus subtile consiste à croire que tout le monde, dans l’organisation, partage une compréhension claire et unifiée de ce qui est en train de se transformer. En réalité, chaque acteur détient une partie différente du puzzle. IT, Finance, RH, Opérations, Vente — chaque fonction travaille à travers son propre prisme, ce qui est normal et nécessaire à la performance.
Mais dans une transformation transversale, ces visions partielles atteignent vite leurs limites. Une évolution de processus dans un service a des répercussions dans un autre ; une nouvelle technologie redéfinit la collaboration ; une nouvelle structure redessine les rôles et les responsabilités.
Sans vision systémique des impacts, ces interconnexions sont souvent découvertes trop tard — au moment du déploiement, quand il est déjà coûteux d’ajuster. C’est à ce moment que surgissent les frictions : désalignements, doublons, priorités contradictoires, ou reprises de travail.
Le Change Manager, à la manière d’un architecte de l’information, agit comme un chef d’orchestre de la compréhension collective. Il ne détient pas toutes les réponses, mais il relie les points, challenge les hypothèses, et aide chaque partie prenante à élargir sa vision.
L’illusion de la vision partagée, c’est de croire qu’elle existe déjà.
En réalité, elle doit être construite — par le dialogue, la confrontation des points de vue, et une analyse commune. C’est ainsi qu’une organisation développe une intelligence collective du changement, au lieu d’y réagir dans l’urgence.
- L’illusion du Change Manager “magicien”
Certaines organisations pensent encore que le simple fait d’engager un Change Manager suffira à “régler” la dimension humaine du changement. Comme si sa présence seule pouvait éliminer les résistances, accélérer l’adoption et simplifier le parcours.
C’est une illusion compréhensible. Parce que le Change Manager apporte de la méthode, de la structure et du recul, on s’attend parfois à ce qu’il “fasse le changement” à la place des autres. Mais son rôle n’est pas de porter le changement seul — c’est de permettre à chacun de le porter ensemble, tout en contribuant activement à sa mise en œuvre.
Un Change Manager expérimenté n’est pas seulement un chef d’orchestre : il agit, conçoit et accompagne concrètement. Il forme les managers au leadership du changement, anime les ateliers d’analyse d’impact, facilite les discussions autour des résistances ou des craintes, conçoit les plans de formation et de communication, et, si nécessaire, intervient jusqu’à l’analyse de processus. En résumé, il fait le lien entre la stratégie et l’exécution.
Son efficacité repose sur cette double capacité :
- questionner, cadrer et structurer la compréhension,
- agir, mobiliser et traduire cette compréhension en actions concrètes.
Une transformation réussie repose sur un écosystème complet :
- des sponsors engagés, qui portent la vision et maintiennent la dynamique,
- des managers impliqués, qui incarnent et relaient cette vision,
- des équipes projet qui traduisent les impacts techniques en impacts humains,
- et des Change Managers qui relient l’ensemble, par la méthode, la compréhension et l’action.
L’illusion du “Change Manager magicien”, c’est de croire qu’il peut agir seul.
La réalité, c’est qu’il agit avec — et souvent pour — les autres, pour donner au changement ses meilleures chances de réussite.
Conclusion
Sous-estimer l’analyse d’impact, c’est comme écarter la boussole qui guide toute transformation. C’est croire qu’on peut agir avant d’avoir compris.
Une analyse d’impact bien menée fait l’inverse : elle aide l’organisation à comprendre avant d’agir, structurer avant de transformer, et ajuster avant de déployer. Elle fait le lien entre la stratégie et les opérations, entre les intentions et les actions, entre les outils et les personnes.
Le Change Manager joue ici un rôle essentiel : celui d’un praticien complet, capable de questionner, concevoir, former, faciliter et mobiliser. Son objectif n’est pas de rendre le changement facile, mais de le rendre possible — et durable.
Parce qu’au fond, la réussite d’une transformation ne dépend pas de la vitesse à laquelle elle est mise en œuvre,
mais de la qualité de la compréhension partagée, et des relations construites autour de cette compréhension.
Et c’est précisément cette dimension relationnelle et collective qui fera le lien avec la suite de cette série —
celle où nous explorerons la manière d’accompagner les managers, les équipes et les utilisateurs pour ancrer durablement le changement dans le quotidien.
✳️ Et vous ?
Ces illusions vous paraissent familières ?
Vous avez peut-être vécu ces moments où tout semble clair… jusqu’à ce que la réalité du terrain en décide autrement.
Si vous souhaitez approfondir ces sujets, partager vos expériences ou être accompagnés dans vos prochaines transformations, je serai ravie d’en discuter avec vous.