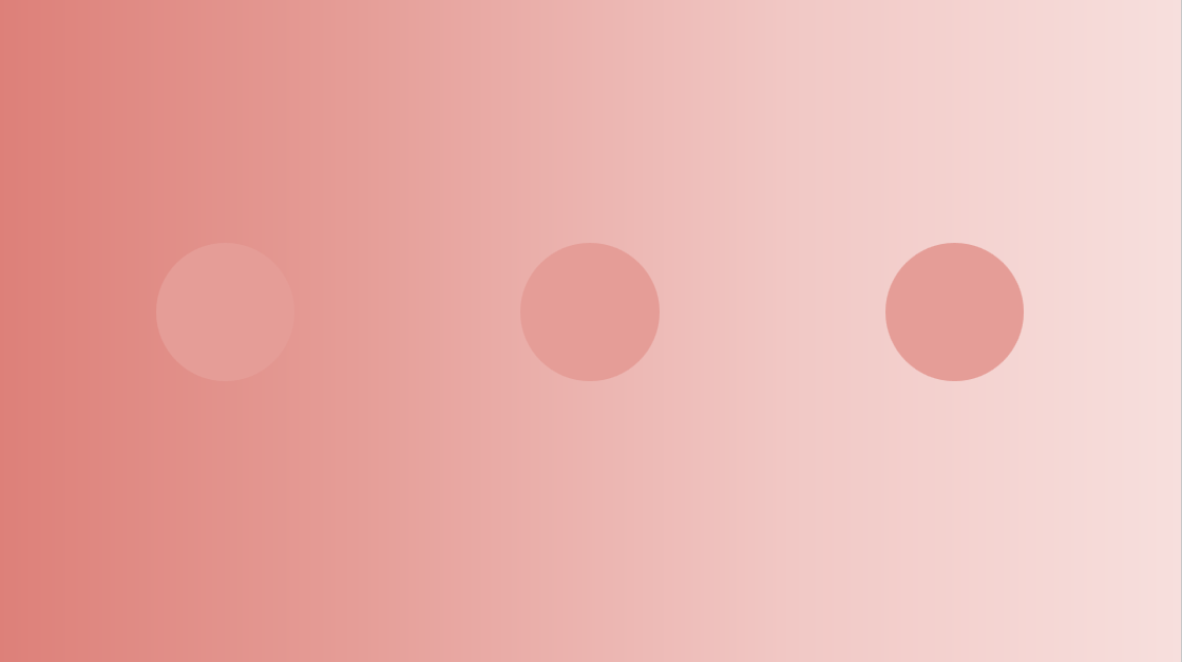
Pourquoi les organisations sous-estiment encore la dimension humaine du changement — et comment assurer une adoption réelle
Les illusions du Change Management (1/3)
Les illusions du Change Management (1/3) – le temps
L’illusion du temps : quand le business avance plus vite que l’humain
Chaque année, les organisations investissent des millions dans des projets de transformation. Déploiement de nouvelles organisations, réingénierie des processus industriels, mise sur le marché de nouveaux produits, implémentation de nouveaux outils informatiques (ERP, IA, etc.), fusions d’entreprises…
Les formes du changement sont tellement variées, mais nombre de ces initiatives échouent à produire les bénéfices attendus dans les délais prévus.
Pourquoi ? Parce qu’encore aujourd’hui, les organisations continuent de sous-estimer la dimension humaine du changement.
L’illusion
L’illusion, dans nombre d’organisations, consiste à croire qu’on peut comprimer le temps du changement humain comme on compresse un planning projet.
Comme si l’humain pouvait absorber un nouveau modèle, un nouveau système ou un nouveau mode de travail à la vitesse d’un déploiement technique.

J’ai souvent été témoin de cette volonté d’aller “un peu plus vite que la musique” : parce que tout semble clair sur le papier, parce que le plan de projet est structuré et les étapes identifiées, les organisations pensent qu’un changement qui nécessiterait naturellement cent unités de temps pourrait être réalisé en quatre-vingts.
C’est une illusion : le temps humain ne se compresse pas, même quand tout paraît prêt.
Chaque transformation comporte un temps humain incompressible — celui qu’il faut à chaque individu pour comprendre, accepter et s’approprier le changement, condition nécessaire à la performance durable dans la nouvelle réalité.
Ce temps varie selon la complexité du changement, la culture et la maturité de l’entreprise, la charge émotionnelle des transformations passées et la densité de celles en cours. Car dans la réalité, les équipes vivent rarement un changement isolé : elles doivent en gérer plusieurs à la fois, tout en maintenant la performance du quotidien. Ce temps humain n’est pas un luxe. Ce n’est pas non plus un caprice.
C’est une variable structurelle, aussi réelle que les contraintes budgétaires ou techniques.
Ignorer ce temps, c’est fausser la planification, fragiliser la performance et retarder le retour sur investissement. Mais à l’inverse, le rôle du Change Manager n’est pas de ralentir le business ou de créer des excuses pour étirer les plannings.
Le changement doit se faire, et il doit se faire dans le rythme du business.
Simplement, ce rythme doit intégrer la réalité de l’humain.
Et c’est ici qu’un autre malentendu persiste :
« Si un Change Manager est impliqué, les gens adopteront plus vite. »
C’est à la fois vrai et faux.
- Vrai, parce qu’un Change Manager professionnel ne se contente pas d’“accompagner” : il mesure, qualifie et rend visibles les impacts.
Il aide les dirigeants à prendre des décisions éclairées, soutient les managers dans leur rôle de traducteurs du changement et lève les obstacles qui freinent la performance.
Autrement dit, il sécurise le temps : il permet d’aller aussi vite que possible, sans perdre en qualité d’adoption ni compromettre la durabilité du résultat. - Faux, parce que même avec le meilleur accompagnement, le temps humain reste incompressible.
On peut le structurer, le rendre plus fluide, l’intégrer dans la stratégie — mais pas l’effacer.
C’est là, dans cette zone de tension entre le temps business et le temps humain, que se joue la réussite d’une transformation. Et c’est précisément là que le Change Manager crée de la valeur : en alignant les deux, sans complaisance, mais avec lucidité.
Pourquoi cela se produit-il ?
Différents acteurs de l’organisation vivent des temporalités différentes :
- Les dirigeants et décideurs ont souvent eu des mois, voire des années, pour se préparer avant l’annonce officielle du changement.
Au moment du déploiement, ils sont prêts à accélérer, avec des délais compressés pour préserver le budget.
Pourtant, le temps accordé à la préparation devrait au minimum être égal à celui consacré à l’adoption — et souvent, il doit même être plus long.
On ne peut pas espérer que l’organisation intègre en quelques semaines ce que les équipes dirigeantes ont mis des mois à concevoir.
C’est une condition essentielle pour sécuriser la réussite et le retour sur investissement. - Les équipes projet travaillent sous une forte pression de livraison.
Dans la réalité actuelle des entreprises, les projets se mesurent en mois, rarement en années.
L’objectif se concentre encore trop souvent sur le go-live technique, et pas assez sur l’intégration humaine. - Les managers de proximité évoluent dans une autre réalité : maintenir l’activité tout en accompagnant plusieurs transformations simultanées.
Pour préparer leurs équipes, ils devraient pouvoir s’arrêter, réfléchir, contextualiser et se préparer au(x) changement(s) — un luxe qu’ils n’ont que rarement.
Pour eux, le Change Manager agit comme un véritable partenaire : il les aide à traduire le(s) changement(s) — stratégique(s) ou non — en impacts concrets et en plans d’action réalistes, tenant compte des spécificités de leurs équipes et collaborateurs. - Les collaborateurs, eux, vivent le(s) changement(s) comme ils peuvent.
Les plus expérimentés ont parfois besoin de plus de temps pour laisser le passé derrière eux (et parfois leur ego professionnel) afin de reprendre confiance avec de nouveaux outils ou processus, et recréer leur zone de confort.
Les plus jeunes apprennent vite techniquement, mais se désengagent si les changements n’apportent pas de réelles améliorations, ou pire, s’ils n’ont pas de sens.
L’adoption n’est jamais uniforme : elle dépend des expériences individuelles, de la dynamique d’équipe et de la complexité organisationnelle.
À cela s’ajoutent les pressions externes — concurrence, réglementation, volatilité du marché — qui accélèrent l’horloge du business, alors que celle de l’humain demeure incompressible.
Comment y remédier ?
Le rôle du Change Management n’est pas d’effacer le temps comme contrainte, mais de le rendre visible, mesurable et gérable.
Trois leviers sont essentiels :
- Intégrer le temps humain dans la planification projet
Une technologie peut être déployée en quelques semaines, mais son adoption prend souvent des mois.
Le planning doit refléter les deux temporalités. - Qualifier et quantifier les impacts
L’analyse d’impact est la pierre angulaire du changement.
Elle doit être systématique, précise et surtout itérative.
À mesure que la compréhension évolue, le parcours de changement et les plans d’action doivent s’ajuster. - Travailler avec les personnes, à tous les niveaux
Un Change Manager n’applique pas de “recettes”.
Fort de son expérience, il mobilise une boîte à outils adaptable au contexte.
Il anime des ateliers, teste avec les employés, soutient les managers dans leur communication quotidienne et offre un accompagnement concret sur le terrain (gestion des résistances, baisse de productivité, etc.).
Parallèlement, il agit comme sparring partner auprès des dirigeants : en apportant un regard externe lucide, en identifiant les obstacles potentiels et en garantissant que les décisions et la communication restent alignées avec la réalité.
Le Change Manager s’intègre donc au centre d’un triangle de collaboration :
- Les équipes projet, qui livrent la solution,
- Les managers de proximité, qui accompagnent leurs équipes,
- les dirigeants, qui fixent la direction.
Au centre, le Change Manager relie ces trois niveaux, assurant la cohérence entre décisions, temporalités et actions.
Et vous ?
Avez-vous déjà été confronté·e à cette illusion du “changement plus rapide” ?
Comment votre organisation gère-t-elle l’équilibre entre temps business et temps humain ?
Si le sujet vous parle ou si vous souhaitez en discuter, je serai ravie d’échanger avec vous — que ce soit pour partager vos expériences, vos questions ou vos défis actuels en matière de transformation.